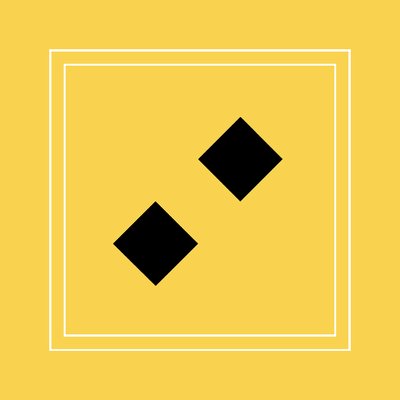Espace de non-mixité, tantôt subi, tantôt choisi, l’assemblée de femmes en période de deuil grouille de vulnérabilité, de sororité et de transcendance. Récit au cœur du harem du deuil, où les femmes puisent inconsciemment une force collective pour faire face à la douleur et surmonter tant bien que mal la perte d’un proche.
Adolescente, ces scènes de femmes en pleurs, agglutinées les unes contre les autres, m’embarrassaient, voire m’effrayaient. Aujourd’hui, je ne sais pas comment vivre ces scènes qui se répètent en cette période tourmentée de crise sanitaire. J’hésite entre observer et analyser le spectacle qui s’offre à moi, ne pas flancher et rester solide comme un rocher sur lequel les autres femmes peuvent s’appuyer ou m’autoriser à me joindre à cette catharsis collective et profiter de ses bienfaits.
« On préfère ne pas être seules, se sentir soutenues »
Le barnum est monté à l’extérieur pour les hommes ; jusqu’à présent, aucune âme ne peuple cet espace. Le salon sera celui dédié aux femmes, mais Covid oblige, nous ne sommes que cinq à attendre l’arrivée du corps. Ma tante l’appelle el sandoq [la boîte], en référence au cercueil. Assise sur un lit, les jambes pendantes, elle se griffe, s’arrache la peau, se flagelle, s’infligeant une douleur physique qui dissipe difficilement la douleur de la perte de son fils.
C’est le deuxième fils dont elle accueille « la boîte » en Tunisie. Le premier s’est noyé à Deauville en 1983, et c’est accompagnée des femmes de tout le quartier sous le choc qu’elle recevait son corps inerte. L’arrivée de cette nouvelle « boîte », elle la craint. Elle s’apprête à la vivre en comité réduit et elle a en horreur sa potentielle réaction. Elle appréhende l’idée de ne pas supporter le choc, de tomber, de s’arracher la peau, de se lamenter, d’hurler. Dès qu’elle mentionne la future arrivée de son fils inanimé, chaque larme versée est une invitation à des pleurs plus bruyants et à des cris incontrôlés. Elle tient difficilement debout, elle a été hospitalisée le mois dernier et est restée alitée.
Mère d’une fille et de huit garçons, vingt-deux fois grand-mère et six fois arrière-grand-mère, cette femme de 85 ans montre du plus profond de sa peine, une force que je n’ai jamais vue auparavant. Armée de son chapelet, elle affronte ses émotions avec un semblant de sérénité. Elle ordonne aux femmes de ne pas crier et de prononcer des louanges à Dieu. Et au moment où on entend ses fils venus de l’aéroport, qui transportent leur frère défunt, pousser la porte d’entrée, elle s’appuie sur son déambulateur et se lève avec fermeté. Sa fille la tient dans ses bras et je me fais difficilement garante du fragile équilibre de ces deux corps endeuillés qui reposent entre mes épaules menues, ignorant toutes les mesures sanitaires qu’on s’était promis de respecter. Le corps entre dans le salon, la masse féminine que nous formons perd l’équilibre et la meneuse, qui n’est autre que ma tante, crie “Allahou Akbar” [Dieu est grand], suivie par les autres femmes et bientôt par les hommes qui portent le cercueil.

Crédit : « El sandoq », Sara H.
Guérison collective
Elle passera la nuit au côté du corps de son fils. Mais le lendemain, le départ pour l’enterrement où les femmes ne se rendent pas, est difficile. Notre Kahina, notre guerrière, notre Mama qui a remplacé nos grands-mères décédées, cette meneuse qui a fait preuve d’une force inégalée la nuit dernière, s’abat sur son déambulateur et hurle le nom de son fils en jetant ses bras en avant. Sa fille, elle, est déjà dehors et suit, démunie, le corps de son frère qui s’éloigne. Mes épaules et mes mains soutenantes de la veille ne sont près d’aucune d’entre elles pour les envelopper, elles ont préféré se retirer dans un coin, face à la foule qui, prenant le relais, s’occupe maintenant de notre aînée. Une foule féminine en sanglots dont je ne perçois que les ombres et les « blancs » des yeux qui ont viré au rouge.
En soutien à cette mère endeuillée, famille, amies et voisines ont fait le déplacement pour l’accompagner dans la plus grande désobéissance civile au protocole sanitaire et pour certaines, malgré l’interdiction de leurs maris. Parmi elles, ma tante paternelle, que j’aperçois près du barnum déserté par les hommes, qui se sont rendus avec le corps à la mosquée pour la prière mortuaire, puis au cimetière. Telle une conférencière, cette tante, que je connais réservée, s’engage dans un récit, face aux regards ébahis des petites-filles de notre Kahina, qu’elle ne connaissait pas quelques heures plus tôt. Je la regarde au loin et n’ose pas interrompre cette prise de parole inattendue. Cette femme porte le deuil de son fils noyé en Méditerranée depuis plus de vingt ans. Elle a un jour confié que lors des enterrements, elle pleurait la mort du nouveau défunt, mais aussi celle de son fils car c’est le seul espace où elle pouvait pleurer. Aujourd’hui, elle raconte à ces jeunes femmes de vingt ans qui ont fait le déplacement depuis la France, les circonstances de la mort de son fils, les deux semaines de désarroi avant que son corps ne soit retrouvé et son deuil inachevé. Pour la première fois, je vois ma tante placer des mots sur ses pleurs, sur ses maux, sans autre accompagnement que ces cercles de femmes qu’elle a continué d’occuper quand son mari avait le dos tourné.
Les femmes ne sont pas les seules à s’autoriser à sangloter dans le harem du deuil. Au retour des hommes du cimetière, les fils se précipitent dans les bras de leur mère et de leur sœur et laissent leurs larmes couler. Quelques heures plus tard, ces larmes vont peu à peu sécher, des sourires amers vont apparaître dans l’assemblée avant que des rires sincères se fassent entendre. La foule disparaîtra les jours suivants et avec elle, la catharsis émotionnelle. Seule la ghossa [boule dans la gorge, chagrin] continuera d’accompagner les trois nuits de veillée mortuaire, subitement écourtées par le décès de la petite sœur de notre aînée.
Permettez-moi de faire l’impasse sur les règles journalistiques et de boucler cet article par une invocation. Ya Wadûd [Ô le Bien-Aimant, le Bien-Aimé], Ya Latîf [Ô le Compatissant, le Bienveillant], que chaque larme versée seule ou en assemblée, que chaque sourire esquissé sur nos visages endeuillés, que chaque rire relâché dans la gêne et en toute humilité apaise cette lame qui laisse nos cœurs se compresser et permette à nos âmes de rayonner. Amine.
Adolescente, ces scènes de femmes en pleurs, agglutinées les unes contre les autres, m’embarrassaient, voire m’effrayaient. Aujourd’hui, elles me rappellent l’importance de la communauté et la puissance des cercles de femmes fermés quand les maîtres-mots sont bienveillance et sororité.

Crédit : Cercle de Kahina, Sara H.
Crédit photo à la Une : Alaa Satir
Diffuse la bonne parole