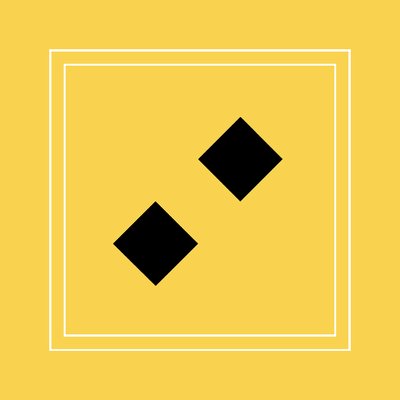Peut-on dire qu’on a toujours été féministes ? Comme beaucoup de militant·e·s en perpétuelle déconstruction, nous avons tou·te·s longtemps reproduit, de manière plus souvent inconsciente que consciente, des stéréotypes et comportements sexistes/racistes/classistes/validistes/homophobes/transphobes…, qui ne participent pas à l’amélioration de notre chère société patriarcale. Mais à partir du moment où nous prenons conscience de nos identités plurielles et de la portée de nos actes, en tant que femmes racisées notamment, nous nous efforçons de remettre en question ces automatismes qui, en plus de jouer en défaveur des minorités, donnent souvent implicitement raison aux oppresseurs.
Dans nos cas particuliers, étant étudiantes en cinéma pour l’une et en études de genre pour l’autre, cette conscientisation a commencé par le désir de mettre en lumière les tentatives de représentations positives des femmes dans le 7ème art, ainsi que dans le milieu militant en France et aux USA. Durant ces travaux de recherche, nous avons pu lire, traduire et écrire à propos des inégalités qui gangrènent les manifestations visuelles dont nous sommes témoins dès que nous sortons de chez nous : de la publicité locale aux blockbusters hollywoodiens, le sexisme n’épargne aucun médium. Mais c’est aussi durant l’écriture de ces travaux que nous nous sommes rendu compte que quelque chose clochait dans nos processus personnels de déconstruction.
En effet, comme toutes bonnes cinéphiles, qui plus est françaises, nous continuions à voir des films faits par/avec des agresseurs, pour la simple et bonne raison qu’“il faut tout voir pour pouvoir dire si c’est mauvais”. Seulement, en faisant cela, nous perpétuions un comportement tout à fait normalisé par le domaine artistique dans son ensemble : nous séparions l’homme du génie. Autrement dit, nous donnions encore une fois raison aux oppresseurs. A l’occasion du Sexual Assault Awareness Month (le mois de conscientisation des agressions sexuelles), nous pensons qu’il est important, si ce n’est nécessaire, de discuter de cet aspect on ne peut plus problématique du cinéma.
Se déconstruire, c’est ne plus financer ni célébrer l’industrie des agresseurs…
Si on part d’un point de vue totalement économique – puisque c’est l’argument qui inquiète et convainc souvent le mieux -, rien qu’en payant une place de cinéma pour voir un Woody Allen ou un Polanski, on participe aux systèmes d’oppression qui continuent à mettre en avant des “génies” accusés de violences. En effet, contrairement à l’idée reçue selon laquelle payer pour voir un film ne serait qu’une goutte d’eau dans l’océan de l’industrie cinématographique, c’est en réalité en grande partie l’argent des tickets de cinéma (et un pourcentage des cartes illimitées également, sorry not sorry !) qui permet aux réalisateurs, acteurs et producteurs accusés d’agressions et/ou de violences sexuelles de refaire des films.
Lorsqu’un film sort en salles, les trois pôles de l’industrie cinématographique touchent un pourcentage de cet argent : qu’il s’agisse des producteurs (qui ont couvert toutes les dépenses nécessaires à la fabrication même du film – acteurs, décors, effets spéciaux, etc ; qui refont des films grâce aux bénéfices des entrées en salle), des distributeurs (qui ont acheté le produit fini et avancent une somme colossale qui sera rentabilisée par les bénéfices) ou des exploitants (ici, on parle des salles de cinéma qui acceptent de projeter le film, sans garantie de rentabilité mais avec le soutien de plusieurs institutions, notamment en France le CNC), chaque pôle de cette industrie est financé en partie par ce billet.
De fait, payer pour voir un film fait par et/ou avec un agresseur, c’est donner un peu de son argent à cette machine infernale qui place les prétendus “génies” sur le devant de la scène, et qui fait totalement abstraction des accusations dont ils font l’objet. Nous sommes conscientes que beaucoup d’artistes se nourrissent de leurs souffrances et de leurs peurs pour guider leurs créations. Chose tout à fait admirable, mais inacceptable lorsque l’on sait qu’il pourrait s’agir également de la souffrance et de la peur de ces femmes victimes de ces grands producteurs d’art. Certaines œuvres, même faites par des agresseurs, ont cette capacité de nous transcender, nous élever et nous transformer, nous ne le nions pas. Mais en tant que consommatrice·teur·s d’art, qu’en est-il de notre responsabilité morale ?

“C’est le moment d’arrêter de séparer l’art de l’artiste abusif : l’artiste abusif profite de ton argent.” Crédit photo : @cameronesposito
Du coup, on nous demande si nous voyons quand même ces films en streaming. Et la réponse reste la même : hell no ! Pour plusieurs raisons ; la plus évidente est que nous ne souhaitons pas donner de crédit à la vision sublimée d’un homme qui, après avoir abusé de la confiance et du corps de femme(s), continue d’être applaudi par tou·te·s. On nous rétorquera que c’est à la justice de juger de la culpabilité d’un agresseur “présumé”. Alors oui, le système judiciaire est effectivement censé donner le bénéfice du doute à tout contrevenant potentiel à la loi. Mais quand on constate que ce bénéfice s’applique seulement à une partie bien spécifique de la société (des hommes blancs cis et hétéros de classe bourgeoise), à laquelle appartiennent la majorité des agresseurs du monde du cinéma, et pas à tous les “autres” (qu’on gaze dans les manifestations pacifiques, qu’on asphyxie lors de contrôles policiers abusifs, qu’on criminalise à longueur de temps dans les médias à grands coups de stéréotypes) : à un moment donné, il faut arrêter de se leurrer et regarder la vérité en face.
Il ne s’agit plus ici de condamner l’artiste et de tolérer sa création, non, non, non. Il n’y a plus de séparation lorsqu’il s’agit d’un·e citoyen·ne musulman·e et/ou d’une personne racisé·e. Ce n’est d’ailleurs pas le système judiciaire actuel, malheureusement mené en grande partie par des figures appartenant au genre, à la race et à la classe dominants, qui donnera raison à toutes ces femmes qui crient #Metoo d’une seule voix. Alors, en attendant que les lois s’adaptent à la dure réalité des survivantes d’agressions et de violences sexuelles, nous ne voulons plus cautionner ce type de films, même gratuitement. L’art parle de lui-même. Il doit être perçu, reçu, critiqué et/ou apprécié dans son contexte spécifique. Un contexte, qui d’ailleurs, en dit plus sur son processus de création que l’œuvre elle-même. Qu’on le veuille ou non, déresponsabiliser l’œuvre d’un agresseur revient automatiquement à déresponsabiliser l’agresseur, qui décide pour nous ce qui est créativement acceptable ou non. En véhiculant l’idée qu’il est possible de séparer l’artiste de son art, nous occultons les vécus de ces femmes dont les vies ont été détruites par ces prédateurs qui en tirent tous les bénéfices.
… et donner du crédit à celles et ceux qui ont survécu et se battent contre les injustices
D’autant plus que, quand on commence à décentraliser notre attention de ces films ultra médiatisés, c’est toute une flopée de visions alternatives et progressistes du monde qui s’offre à nous. Parce que oui, ce que ces “réalisateurs de génie” véhiculent souvent dans leurs films, ce sont aussi des points de vue très contestables sur le monde. Comment séparer l’homme du génie, alors que tout travail de création est empreint d’une subjectivité propre à chaque artiste ? Et ce n’est pas nous qui spéculons (nous voyons déjà se profiler les réactions misogynes sur une prétendue hystérie féminine…), les plus grands chercheurs de cinéma – comme Guy Gauthier, dans Le documentaire, un autre cinéma – affirment que même le documentaire, genre supposé servir une vision objective du monde, porte avec lui une part de subjectivité. Parce que derrière chaque caméra, il y a un homme ou une femme, avec un vécu, des belles expériences mais aussi des actes ignobles. Et bien souvent, ces vécus déteignent sur les films qu’ils·elles créent : Woody Allen, accusé d’agression sexuelle par sa fille, Dylan Farrow, lorsqu’elle avait sept ans, passe son temps à faire des films qui mettent en scène un vieux croûton (qu’il a même des fois incarné lui-même !) qui séduit, se sert et maltraite psychologiquement une jeune fille qu’il dépeint toujours trop naïve pour voir clair dans son jeu d’artiste maudit. C’est, par ailleurs, typique du féminisme blanc que de boycotter Harvey Weinstein, Louis CK et bien d’autres, tout en célébrant la décision très politique de Wonder Woman qui se voit interprétée par Gal Godot. Sommes-nous censé·e·s séparer l’actrice de la soldate de Tsahal, armée qui a tué d’innombrables innocent·e·s, que ce soit dans le contexte de l’occupation de la Palestine, de la guerre du Liban ou encore des bombardements sur Gaza ?

NON. Nous avons nos propres Wonder Women chez Lallab, et Gal Godot n’en fait certainement pas partie. La dissonance cognitive qui règne concernant l’occupation palestinienne ainsi que celle de la culture du viol, sont toutes les deux la pénétration interminable d’un néfaste habitus, accepté, puisque banalisé, que nous devons absolument condamner. En continuant sans cesse à se nourrir de ce genre de représentations, à la fois des relations hommes/femmes et de la sublimation du statut d’artiste abusif, on intègre et on normalise ces comportements inacceptables. Alors quand, au lieu de consommer passivement le produit du travail de ces hommes acquittés d’office par la critique, nous pouvons aller voir des films qui ne seront peut-être pas parfaits certes, mais qui mettent en avant des figures subversives de femmes fortes et d’hommes s’éloignant des normes de la masculinité toxique, qui ne sont plus des objets du regard mais les sujets de leur propre histoire : comment dire… le choix est vite fait.
Nous ne disons pas que c’est un choix facile, bien au contraire. C’est le fruit d’années de réflexion, à la fois sur nos pratiques du cinéma, du genre, de la culture en général et surtout sur nous-mêmes, nourries de lectures, de questionnements et de remises en question qui nous ont plus souvent mis dans des situations inconfortables que plaisantes. De plus, nous aussi, nous avons pu aller voir des films problématiques à plusieurs échelles : nous ne nous plaçons pas en modèles, mais proposons une autre façon de consommer le cinéma, maintenant que nous sommes conscientes de ces paramètres précis. Car se déconstruire, c’est aussi cela : accepter que l’on a pu faire les choses de manière approximative et/ou problématique auparavant, et prendre des initiatives pour donner du sens à sa lutte en dépit de l’inconfort. Personne ne nous avait dit qu’être militantes serait parfois désagréable, but guess what : on préfère cent fois vivre le malaise de la déconstruction que jouir du privilège de l’ignorance choisie, qui continue de heurter tant de femmes autour de nous.

Nous pourrions donner mille autres arguments pour défendre ce point de vue, que nous savons controversé et très peu accepté par nos cercles proches comme par les membres du monde du cinéma et de la culture. Mais l’un des points les plus sensibles de ce choix – mais aussi le plus central à nos yeux, c’est notre réel désir de déconstruction totale. Nous aspirons à être des féministes intersectionnelles actives sur tous les fronts qui, au lieu de célébrer les “génies” du cinéma qui agressent impunément des femmes depuis la nuit des temps, font honneur à toutes les femmes survivantes de ces agresseurs. Si l’affaire Weinstein a permis une libération de masse des voix de ces femmes ayant vécu des agressions et des violences sexuelles, il s’agit de ne pas oublier que celles-ci n’ont pas commencé à avoir lieu dernièrement, ni exclusivement dans le milieu du cinéma. En ne passant plus l’éponge sur ces comportements inacceptables qui restent encore majoritairement impunis, nous rendons aussi modestement hommage à toutes les femmes fortes de nos familles et de notre entourage, qui ont vécu ou vivent encore des traumatismes physiques et psychologiques dus à des comportements violents du même type.
Contrairement à Dylan Farrow qui avait écrit une lettre ouverte à propos de son agression par son père, nous n’avons pas tou·te·s, d’une part, le courage et le choix de dénoncer les agressions et violences que nous vivons ou avons vécu, et, d’autre part, l’accès à un espace médiatique de l’ampleur du New York Times. Mais quand des survivantes comme Farrow prennent la parole, c’est un peu de chacune de nos expériences d’injustice qu’elles portent en même temps avec elles. Ainsi, comme il est totalement hypocrite de jouer dans le film d’un agresseur tout en arborant un costume noir en soutien aux victimes de harcèlement aux Golden Globes (big up Justin Timberlake et autres professionnels du non-sens comme James Franco), quel sens ont nos luttes si nous cautionnons des productions modelées par des agresseurs qui, comme ceux de nos grands-mères, amies, connaissances proches ou lointaines que l’on a battues, violées, soumises au pire, jouissent d’une totale impunité, en plus de la célébrité ? Pour ces femmes qui nous ont forgées et ont permis que nous soyons aujourd’hui les militantes féministes et antiracistes que nous sommes, nous refusons de participer consciemment à ce système d’oppression que peut souvent être le cinéma : non merci !

Pour finir, nous croyons qu’il est important de rappeler que le cinéma n’est pas qu’un simple divertissement. C’est le reflet actif de la société dans laquelle nous vivons, le résultat des choix répétitifs que nous faisons, et donc l’objet malléable sur lequel nous pouvons avoir un impact non négligeable, dans nos efforts quotidiens pour la mise en place d’une société plus juste. Ce changement ne se fera bien sûr pas du jour au lendemain. Mais petit à petit, on voit des alternatives se mettre en place (les initiatives de représentations positives des minorités dans les blockbusters américains avec dernièrement Black Panther, Un raccourci dans le temps, etc), des groupes de femmes mettre en avant les bienfaits de la sororité (de Time’s Up à Lallab, on lâche rien !), des sites comme Rotten Apples qui proposent même d’entrer le nom d’un film pour vérifier dans une base de données contributive si un agresseur a participé à la production ou à la réalisation de celui-ci. Les choses changent, et nous ne sommes plus seul·e·s face à l’immensité des injustices de ce monde. Alors, si on commençait à agir sur tous les fronts, à commencer par les plus anodins, en apparence, comme… aller au cinéma par exemple ?
Article co-écrit par Tarani et Selma
Crédit Photo image à la Une : @samahfaitrire pour Lallab
Diffuse la bonne parole